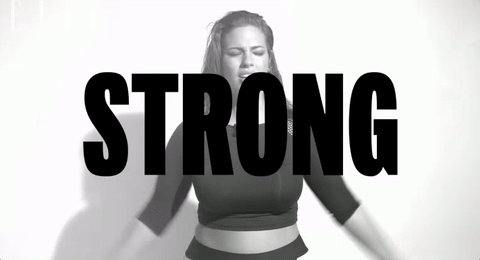Franchement, j’ai vécu toutes les galères que des millions d’usager·e·s du RER avaient vécu avant moi et vivront encore après moi : présence d’objets ou de personnes sur les voies, ralentissements, travaux, annulation subite de train, quai bondé dès la gare de départ qui te fait te dire que tu vas en chier ce matin, rame bondée ras-la-gueule où le concept de promiscuité est poussé à son paroxysme, canicule dans une rame sans climatisation, accident grave de voyageur avec changement de plan de route et traversée du tapis roulant vers la ligne 1 du métro à Châtelet en mode immobile, fumeurs de cracks, accordéonistes qui reprennent (torturent) Mon Amant de Saint-Jean… Je pense que si l’aventure avait un nom et elle s’appellerait RATP.
La plupart du temps, pour survivre à ce genre d’aventure, j’étais bien équipée. Casque sur les oreilles, batterie du téléphone chargée à bloc, bouteille d’eau et bouquin dans le sac à dos, gants, écharpe et bonnet en hiver, éventail et brumisateur en été, j’étais parée à une longue attente sur le quai, un ralentissement ou même un arrêt de plusieurs minutes à une station parce qu’un mec avait éternué à Arcueil-Cachan et que ça avait déréglé le subtil équilibre du trafic de toute la région. Mais parfois, je ne suis qu’humaine, que voulez-vous, parfois, je merdais. Je partais un peu à la bourre et je ne faisais pas attention et paf ! J’oubliais mon casque ou mon livre du moment dans ma voiture ou je me rendais compte que mon téléphone n’avait pas correctement chargé pendant la nuit et que je n’aurai jamais assez de batterie pour écouter de la musique et pouvoir passer un appel à mes boss en cas de gros retard. Je devais donc me passer de ma bulle de protection anti-merdier et je devais faire face au reste du monde qui partageait la rame avec moi. Et là, j’ai vécu de grands moments.
J’ai souvent fait semblant de ne pas écouter des interactions formidables entre voyageurs, j’ai saisi au vol des conversations téléphoniques à base de « incroyable avec toi ? Laisse-moi être bien clair avec ces gens : j’en ai rien à foutre moi, qu’ils aient été incroyables… » avant de passer à la conversation suivante ou d’essayer de décoder le bourdonnement musical qui sortait des écouteurs de la personne assise en face de moi, un peu comme tenter d’interpréter le ballet des abeilles qui butinaient ses oreilles avant de venir polliniser les miennes. J’adorais faire ça ! Ce que je préférais, c’était quand la-dite personne écoutait un morceau que je connaissais et, encore mieux, que j’aimais aussi. Je me mettais alors à fredonner ouvertement les paroles pour qu’il ou elle se rende compte qu’on partageait quelque chose, que tous les deux, on était unis dans notre douleur par la musique. Parfois, on échangeait un regard de connivence, genre « hé, ouais, moi aussi j’ai RATM dans ma playlist, heureusement d’ailleurs parce que, pfiou, cette journée commence mal ». Parfois, la plupart du temps à vrai dire, il ne se passait rien et je restais bredouille de ma tentative de communion, faisant face à une personne trop enfermée dans sa bulle pour se rendre compte que j’existais.
Et puis, un jour, il m’est arrivé une drôle d’histoire.
C’était un jour de rame bondée et de trafic ralenti. Le train n’avançait pas, le chauffeur nous faisait de brefs briefs au micro pour nous expliquer la situation quand il parvenait à obtenir quelques maigres informations ; j’avais vite compris que ça allait être un de ces trajets de l’enfer et j’avais pris mon mal en patience en mettant de la musique très fort dans mes oreilles pour oublier où j’étais, pour oublier que j’allais arriver en retard, que j’avais chaud, que j’étais debout et que j’avais mal au dos, que j’avais des gens collés de chaque côté de moi ou presque à tel point que je pouvais sentir le parfum de leur shampooing ou de leur (absence de) déodorant.
À je ne sais plus quelle station, je crois que c’était Bagneux, ce type est entré dans la rame et a réussi à se faufiler pour occuper la même place, pile en face de moi : coincé entre la porte, les gens et adossé aux premiers sièges de la rangée suivante. Nos regards ont rapidement fini par se croiser, tous symétriques qu’on était, et on a échangé un petit sourire de connivence, habituel dans ces moments de foule où tu as le choix entre te morfondre ou tenter de voir du beau au milieu de la merde. Nous, visiblement, on essayait tous les deux de positiver cette aventure et en nous souriant, brièvement, du coin des lèvres, on a semblé se dire « ouais, it’s just one of those days ».
Quand il était entré dans la rame, je l’avais trouvé plutôt lumineux et charmant, chose peu courante les jours de rame bondée où tout le monde est saoulé et moche. Il avait la peau mâte, des cheveux mi-longs noirs qui ondulaient un peu, des yeux marron qui pétillaient. Il venait soit de revenir d’un an de méditation transcendantale en Inde, soit de tirer un coup la nuit précédente. En tout cas, c’est l’histoire que je lui imaginais – je faisais souvent ça, pour passer le temps dans les transports, j’essayais de construire la vie des gens que je croisais, de leur donner une destination, un projet pour la journée ou un passé. Et mon inconnu, lui, avait tout l’air du type heureux, ouvert, presque béat, à croire qu’il était amoureux et qu’il venait de quitter l’élu·e de son cœur sur le quai et qu’il était encore plongé dans les effluves de son parfum, dans l’odeur du creux de son cou et dans le goût de ses baisers. Et tandis que je pensais à tout ça, que je me faisais un avis sur la vie inventée de ce mec que je ne connaissais pas, je continuais d’écouter ma musique très fort, pour ériger ma bulle de plus en plus haut entre les autres passagers et moi. Et je les observais, je passais des unes aux autres, je faisais le point avec mon regard, je zoomais-dézoomais sur les gens qui m’entouraient tout en fredonnant les chansons qui passaient dans mes oreilles. Et je sais que je ne suis pas discrète quand je fredonne, même silencieusement, je sais que mes lèvres remuent même si aucun son ne sort, je sais que mes mains battent la cadence sur ma cuisse inlassablement parce que quand je suis dans ma bulle, il n’y a plus que la musique et moi. Et puis quelque chose m’a appelé hors de ma bulle, un quart de dixième de seconde. C’était le regard de l’inconnu heureux. Il me fixait, moi, en souriant, visiblement amusé par la passion qui m’animait. Re-sourire de connivence. Moi, un peu gênée mais au fond, amusée aussi de voir que nous étions deux à observer le monde tout en mettant la bande-son qui nous plaisait dans nos casques. Je détournai le regard pour naviguer de nouveau dans la rame et revins rapidement vers lui, du coin de l’œil, feignant de ne pas le regarder mais faisant tout pour y parvenir et je le vis, lui aussi, fredonner et marquer la cadence avec ses mains sur sa cuisse.
Sourire en coin de ma part, sourire plus franc de la sienne. Il avait vu que je l’avais vu. On savait tous les deux. On était deux dans le même bateau, dans la même galère, mais on avait, visiblement, tous les deux la même recette pour tenter de s’en extraire. Et ça nous amusait, ça nous remplissait de joie de voir que, juste là, dans une autre bulle en face de nous se trouvait quelqu’un qui faisait pareil. Alors on a continué de s’amuser ensemble. À chaque fois qu’un morceau se terminait et passait au suivant, je marquais une pause physiquement, levant les yeux au ciel pour lui indiquer que j’étais dans l’attente, que je plongeais dans un court silence avant de pouvoir de nouveau partager le plaisir de ma bulle de musique avec lui. Et à chaque morceau, il m’interrogeait du regard « Alors, c’est quoi ? C’est un morceau que tu aimes ? », et moi je lui répondais en souriant, en chantant silencieusement et en battant le rythme avec ma main sur ma cuisse. Et il faisait pareil quand le morceau cessait de jouer dans ses oreilles. Je guettais sa réaction au moment où les notes lui parvenaient et je m’illuminais en même temps que lui de voir qu’aléatoirement, c’était tombé sur un morceau qui lui plaisait.
Au bout d’un certain temps, il ne resta plus que nous deux. Les autres voyageurs avaient beau monter et descendre de la rame et s’agglutiner entre nous, on se cherchait du regard et on finissait toujours par se retrouver et on se voyait et on souriait. Nos deux bulles étaient reliées puis elles ont fini par fusionner. À un moment, j’ai même eu l’impression que lui et moi, on dansait. Je nous visualisais tous les deux, dans la rame, comme dans un film, comme dans une comédie musicale. Les gens se seraient écartés, auraient formé un cercle autour de nous et nous deux, on aurait dansé, chacun sur notre propre musique mais tous les deux mus par la même passion, par la même joie, par le même sentiment d’amour que nous procuraient les notes que l’on entendait. Et même si on n’a pas vraiment dansé, même si on a à peine remué la tête et tapé discrètement la main sur nos cuisses respectives, lui et moi, on savait ce qui se passait, on savait qu’on était entrés dans un duo étrange, irréel, dans un partage de sensations sans contact, dans une danse à distance. Sans se quitter du regard, on a dansé. On a chanté, les yeux dans les yeux, des chansons différentes, et qui pourtant nous unissaient. J’avais la sensation de ses mains sur mes hanches et des miennes autour de son cou. On ne se quittait plus des yeux et dans nos têtes et dans nos cœurs, on était plus que tous les deux. Il me faisait tourner, me serrait contre lui, toujours plongé dans mon regard, et moi je le suivais, l’enlaçais, m’avançais et m’éloignais au rythme d’un orchestre qui n’existait pas et que l’on entendait pourtant bel et bien, juste lui et moi.
On n’était plus dans une rame de RER, on était dans un autre monde et on sentait tous les deux la chaleur de nos corps et, rien qu’avec nos yeux, on savait que nos cœurs battaient un peu plus fort.
Et soudain.
« Châtelet-les-Halles. Châtelet-les-Halles. Attention à la marche en descendant du train. Please mind the gap between the train and the platform ».
On a cessé de danser, d’un coup. L’orchestre s’est arrêté aussi brutalement qu’il avait démarré. La foule entre nous a commencé à se dissiper, les gens, à descendre de la rame. Je devais m’en aller, moi aussi, mais je n’en avais pas envie. Je voulais rester et encore danser avec lui !
Toujours sans me quitter des yeux, il s’est dirigé vers la sortie. On a fait quelques pas côte à côte, le temps de quitter notre bulle. On s’est à nouveau regardé quand on a atterri sur le quai. On s’est dit au revoir avec les yeux. On s’est remercié silencieusement pour cette danse imaginaire. On s’est dit à coup de pupilles et de sourires que c’était génial, qu’on n’avait jamais vécu un truc pareil, merci, merci du fond du cœur. On s’est souhaité une bonne journée, toujours sans parler. On a murmuré chacun dans notre tête « J’aimerai beaucoup te revoir »…
Je crois que je lui ai frôlé la main, hésitant à l’attraper pour lui demander son nom, son numéro, pour lui dire qu’on pourrait à nouveau danser ou qu’on pourrait peut-être simplement boire un café. J’ai senti le même micro-mouvement au niveau de ses doigts, je l’ai vu soupirer et tout comme moi, se résigner, se dire que ce n’était probablement pas une bonne idée.
Finalement on s’est laissé partir, chacun de notre côté, chacun dans notre journée.
On a cessé de se regarder et on a tous les deux disparu dans la foule.
Nos bulles se sont définitivement déconnectées et on s’est perdu de vue.
J’ai continué à prendre le RER tous les jours ou presque, à raison de plus ou moins trois heures par jour. J’ai continué à écouter la musique très fort dans mes oreilles, à ériger ma bulle très haut pour me protéger des autres passager·e·s. J’ai continué, parfois, à écouter les conversations des gens autour de moi. J’ai évidemment continué à imaginer des vies à mes compagnons de galère. Quant à mon danseur lumineux, j’ai eu, pendant quelques semaines, un petit sursaut quand j’entendais le nom de la station où il était apparu, mais je ne l’ai définitivement jamais revu.
La vie est drôle parfois. Elle te met de la musique et de la danse dans le cœur quand tu ne t’y attends pas, puis elle te laisse te démerder avec ta sensation de rêve éveillé sans te donner d’explication ni de comment ni de pourquoi.
Tant pis. C’est comme ça. Je me dis qu’au moins, j’ai eu la chance de vivre une expérience comme celle-là. Et peut-être qu’un jour, si je reprends le RER ou même, un autre train, un autre bus, une autre vie, je retomberai sur mon compagnon de danse imaginaire. Et on se reconnaîtra. Et on se sourira. Et on dansera encore une fois.