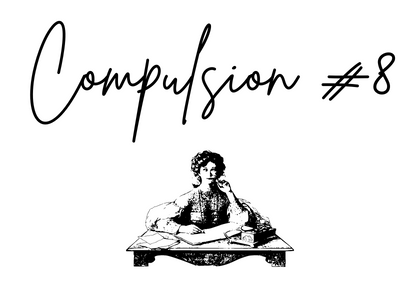Ne m’oublie jamais
Un concept pour lequel il y a sûrement un mot en allemand que je ne connais pas
Le sentiment de nostalgie que me provoque l’écoute de certains morceaux des années 1980.
Ce matin en amenant mon fils à l’école, il y avait Simple Minds “Don’t you forget about me” à la radio, et bien que je l’aie entendue au moins 10.000 fois, cette chanson me provoque toujours un truc étrange au cœur. Immédiatement, je suis projetée à la fois dans la salle de colle des élèves de Breakfast Club, et dans la chambre de mon enfance. Ça me fait la même chose avec Tears for Fears, quand j’entends “Sowing the seeds of Love”, “Everybody wants to rule the world” et “Shout”. Je ne sais pas si c’est lié au fait que je sois née en 1984 et que ces morceaux devaient passer en boucle à la radio à l’époque ou si j’ai inconsciemment entendu ces sons quand j’étais encore dans le ventre de ma mère, mais à chaque fois, ça ne loupe pas, je ressens une sensation bizarre dans le cœur, une torsion, une sorte de bouillon qui fait à la fois du bien et à la fois mal. Et le plus fou, c’est que ça me fait à peu près la même chose quand je tombe sur une cover de l’un de ces morceaux. La version de Shout de Disturbed, par exemple, est pour moi aussi puissante que l’originale, même si celle du groupe de néo métal des années 2000 me ramène sur un quai de la Gare de Lyon Part-Dieu plutôt que dans ma chambre de gamine.
Je ne sais pas s’il existe un mot en français, en allemand, en japonais ou en islandais qui décrit cette sensation, mais je suis fascinée par ce phénomène, au point d’en avoir créé une rubrique sur mon blog il y a des années, dans laquelle je parle plus particulièrement des albums qui m’ont marquée dans l’adolescence et de tout ce qu’ils m’évoquent comme souvenirs et émotions encore aujourd’hui. J’avais déniché un article, paru sur Slate, qui expliquait le mécanisme derrière ces émotions greffées aux musiques de notre passé adolescent et j’avais trouvé ça presque magique, le fait que notre cerveau et sa chimie participent à l’amour que l’on porte à des morceaux de musique parce qu’on les a entendus pour la première fois à un âge fondateur de notre identité.
Avec ces tubes des années 80, ceux de mon enfance, voire de ma petite enfance, il y a quelque chose d’un peu différent – même si je pense que le phénomène trouve racine dans les mêmes mécaniques de constructions neuronales qu’à l’adolescence.
Je ne sais pas trop l’expliquer. J’éprouve une vraie passion pour les sonorités de l’époque, les synthés, les sons de batteries qui n’en sont pas vraiment, tous ces sons électronisés, synthétisés, ces pseudos-flûtes, ces échos dans les voix, ces fondus en noir à la fin des chansons, ces saxophones… Ça ne me fait pas vibrer pareil que les autres styles de musique.
La musique est la langue des émotions. Emmanuel Kant
Je pense que mon attrait pour la nouvelle génération de synth wave vient de là. Je retrouve ces sons “désuets” modernisés et ça me provoque le même sentiment de nostalgie, de bonheur, de peine, cette douleur étrange, cette torsion littérale de mon cœur comme s’il était une éponge pleine des larmes de mon enfance que j’essorais dans un évier en faisant la vaisselle et que ça me faisait un bien fou.
Je sais, c’est bizarre, même si je pense que je ne dois pas être la seule à ressentir ça. On n’est jamais vraiment le·a seul·e à ressentir quelque chose. Je me suis aperçue de ça à force de lire et de partager des pensées randoms sur Twitter. On ressent tous·tes les mêmes choses, à un moment donné, de manière plus ou moins identique. On se reconnait tous·tes à un moment donné dans le mème “that feeling when” d’un·e autre. On partage tous·tes cette capacité à ressentir des choses intenses grâce à la musique. On partage tous·tes des expériences similaires à l’écoute d’un morceau, ou lorsque que l’on sent un parfum particulier.
C’est la “Madeleine” de Proust dans toute sa splendeur, ce sentiment universel de se retrouver dans un autre espace-temps lorsque nous entendons, sentons, goûtons ou touchons quelque chose (je n’ai pas l’impression de ressentir ça par le biais de la vue, mais peut-être que vous oui, vous me direz en commentaires, si vous voulez).
Je pense que ces morceaux des années 80 ont un impact encore plus fort en moi parce qu’ils sont ancrés dans la pop culture. Le clip de “Sowing the seeds of love”, par exemple, cet hommage psychédélique primé aux Beatles, c’est l’essence même de MTV pour moi, une chaine dont je me suis gavée quand j’étais enfant et ado parce que j’avais la chance d’avoir le câble dans mon immeuble et du coup, accès à MTV, la chaîne de la musique et de l’entertainment à l’américaine. Pour moi qui ai toujours été fascinée par les États-Unis et leur (pop) culture, c’était comme si je regardais l’Évangile en direct. J’ai découvert des milliers de clips, d’artistes, d’animateur·ices, mais aussi des séries cultissimes que je ne comprenais pas encore tout à fait alors que les sous-titres français n’étaient pas légion, comme Daria ou Beavis and Butthead.
J’ai un souvenir particulier du clip de Tears for Fears : il passait toujours dans des espèces de pubs à rallonge, séries de montage enchainé de clips, pour promouvoir des compilations 4 CD que l’on pouvait commander par téléphone. Ce morceau est tellement culte qu’il a été utilisé dans des centaines de publicités, de films ou de séries. C’est le genre de chanson que tout le monde, ou presque, peu fredonner car iel l’a forcément déjà entendu quelque part.
C’est comme l’intro de “Everybody wants to rule the world”, ce petit coup de synthé et son riff de guitare, qui apparaissent toujours dans les films au moment de la scène de flashback dans les 80’s.
Rien qu’en entendant l’intro, on s’attend à entendre une voix-off dire un truc du genre “C’était l’été 1987, au camp de vacances Witchita Falls et je ne savais pas encore que j’allais vivre l’aventure la plus extraordinaire de ma vie…”, comme le fait Bébé au début de Dirty Dancing sur “Be My Baby » des Ronettes.
Dans ma tête, je vois des gens dans des blazers colorés, les manches retroussées, des filles permanentées en mini jupes fluo, des bandeaux de sports autour des poignets, des sacs bananes à la ceinture… Ces chansons sont tellement ancrées dans mes souvenirs télévisuels que je me les projette invariablement dans des scènes de vies que je n’ai pas vécues, filmées, mises en scène, éclairées au spot et baignées dans des halos surréalistes.
L’exemple type, c’est l’utilisation de ce morceau dans le film hommage à la pop culture qu’est Ready Player One. C’est presque méta tant le morceau en lui même représente déjà un pan de la pop culture, l’hymne d’une époque fondatrice de tout ce qui nous a par la suite bercé sur nos écrans. Dans le film, il apparait au moment où on nous raconte comment a été créée l’OASIS, le “metaverse” autour duquel se situe l’action du film. C’est évidemment une scène de flashback dans les années 80 et il n’y avait aucune autre chanson capable d’aussi bien illustrer cette scène à mes yeux (et je n’arrive pas à trouver la scène en ligne pour vous la partager ici, punaise !).
Le morceau Don’t you forget about me, apparait, lui, dans la scène de fin du film The Breakfast Club, au moment où tous les élèves sortent enfin de leur samedi matin de colle, après avoir vécu l’aventure introspective la plus extraordinaire de leur vie de lycéen·es américain·es.
Tout est parfait dans le choix du morceau. Le fait qu’il soit sorti à la même époque que le film, mais aussi, qu’il illustre cette scène où les élèves s’adressent à leur principal dans leur lettre-essai commune, comme un dernier coup de rébellion face à une autorité qui les opprime. L’image finale du personnage de John Bender, le poing levé, traversant le stade de foot du lycée, alors que résonnent les mots “don’t, don’t, don’t, don’t, don’t you forget about me” (ne m’oublie jamais, jamais, jamais…) rajoute une couche de culte au film, ce film que des générations entières n’ont pas oublié, tout comme la chanson qui le conclue.
Je crois qu’au-delà de leur statut de musique culte d’une époque, ces quelques morceaux de Tears for Fears et Simple Minds constituent d’un certaine façon, la bande son de mon enfance idéalisée, une enfance passée devant la télé, à rêver d’Amérique, à m’imaginer héroïne des teens movies et des clips qui me fascinaient, à m’envoler au dessus de l’Atlantique pour m’échapper de ma petite ville de province française où il ne se passait rien d’extraordinaire, car aucun film ou série n’y prenait place.
Je me demande ce que ça fait d’avoir été un enfant des années 80 aux États-Unis, d’avoir grandi dans une ville similaire à celles des films cultes, d’avoir marché dans les vrais couloirs d’un collège avec des casiers de chaque côtés, d’avoir regardé pendant des heures par la fenêtre de la salle de classe pendant que l’équipe de football américain s’entrainait et que les pom-pom girls répétaient leur chorégraphie pour le prochain soir de match.
Je me demande ce que ça fait d’avoir grandi dans une réalité cinématographique.
Je me demande ce que ça fait d’avoir vécu dans un monde que des centaines de millions de gens n’ont vu qu’à travers leur petit écran de télévision.
L’Amérique a ce talent de m’avoir fait rêver pendant des décennies, et, aujourd’hui encore, bien que j’en sache plus sur le pays et que je me sois rendue compte de ses nombreux défauts, j’éprouve toujours cette fascination pour lui, parce que l’industrie du cinéma, de la télévision et de la musique m’ont vendu un rêve duquel je n’arrive pas à me réveiller. C’est l’un des super-pouvoirs de l’Amérique, d’ailleurs : avoir réussi à nous vendre une image, un concept, une âme, une culture qu’on a fini par intégrer et considérer comme réelles et réalistes.
C’est probablement une vision de millenial et je pense que les générations futures n’auront pas la même que moi, pas avec tout ce qui s’est passé depuis les années 80 dans le monde et aux États-Unis particulièrement, et pas avec internet comme mémoire collective consultable à volonté.
Moi, ma mémoire collective, elle a été en partie construite à partir de VHS et de DVD, de CD et de cassettes audios estampillés d’un gros drapeau étoilé et transpirant le soda. Elle est forcément biaisée.
Damn you, USA !1
Quelques articles sur le sujet des émotions musicales :
- L’article de Slate de 2014
- Les émotions musicales dans Pour la Science (payant)
- La musique nous reconnecte à nous-même dans Cerveau & Psycho (payant)
- Émotions musicales dans Cerveau & Psycho (payant)
Notez l’ironie dans le fait que les chansons qui m’évoquent la pop culture américaine soient celles de groupes britanniques. Allez savoir, dans mon esprit d’enfant, l’Amérique et l’Angleterre, c’était la même chose ou presque, certainement.