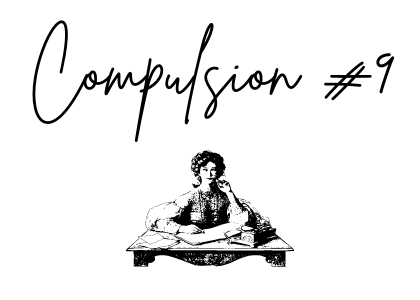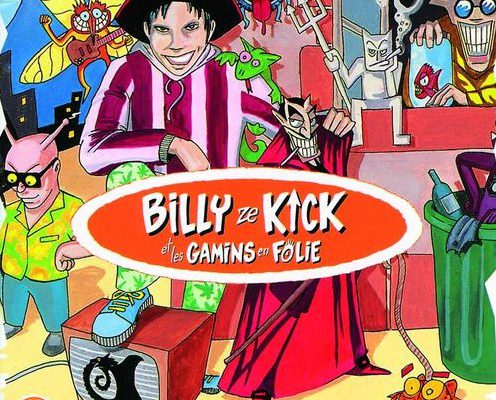Le stylo qui regarde le stylo
Un cliché
Les écrivain·es qui écrivent des personnages qui écrivent.
Je suis en train de lire plusieurs livres en même temps, en ce moment. Ça m’arrive parfois quand je suis pas “à fond” dedans, j’oscille entre deux voire trois livres parce que les trois me plaisent mais aucun ne prend jamais le dessus sur les autres.
Ces temps-ci, je suis principalement dans L’École des Soignantes de Martin Winckler et The Confession de Jessie Burton, deux livres tout de même très sympas.
Dans ces deux livres, un des personnages principaux est un·e écrivain·e, ce qui m’a fait réaliser que ce n’est pas la première fois que dans les romans que j’ai lu ces dernières années - ou sur les quatrièmes de couv’ de romans que j’ai lues sans lire les livres - les personnages de romans sont des écrivain·es.
Quand je regarde dans la liste des livres que j’ai lu l’an passé par exemple, dans six d’entre eux, il y a un personnage d’écrivant·e (auteur·ice de livres, essayiste, journaliste, scénariste…). Coïncidence ou réalité scientifique, ce sont souvent des romans écrits par des auteur·ices français·es qui mettent en scène d’autres écrivant·es.
Beaucoup de romans (plus ou moins connus et reconnus) mettent en scène des écrivain·es, rien de nouveau sous le soleil - Shining de Stephen King, Lettre d’une inconnue de Stefan Zweig, L’Anomalie de Hervé Le Tellier et des milliers d’autres - et le fait que le personnage écrive est parfois même capital pour l’intrigue. Cependant, j’ai souvent le sentiment que certain·es auteur·ices, à travers ces personnages d’écrivant·es essayent de se raconter un peu, sans vraiment le faire et parfois, même, j’ai l’impression que cela sert uniquement de raccourci pour ne pas avoir à construire un personnage, le cliché de “L’Ecrivain·e” semblant se suffire à lui-même.
Je me trompe très probablement, je n’ai encore une fois aucune preuve de ce que j’avance, et peut-être que je projette ma propre vision d’autrice dans ce constat, mais je dois reconnaitre qu’au fond, il y a un truc qui me dérange avec les personnages de romans qui exercent le métier d’écrivain·es. Il y a quelque chose de l’ordre de l’auto-contemplation, comme dans les films qui parlent d’acteur·ices. La caméra qui regarde la caméra, le stylo qui décrit le stylo… ça a tendance à me gêner - et je dis ça en plus, alors que j’avais essayé d’écrire un personnage de journaliste, basé sur mes propres expériences (et que ça avait fini par me gonfler).
Peut-être que c’est un trope que j’ai trop lu/vu dans ma vie et qui commence à me gonfler - la jeune journaliste de mode qui cherche l’amour mais ne veut pas mettre sa carrière de côté non plus, l’écrivain/scénariste de cinéma mal dans ses baskets qui essaye de combattre la page blanche en trompant sa femme, l’écrivaine homosexuelle de quarante-cinq ans habituée des milieux undergrounds et des galeries d’art contemporain entourée d’une clique hétéroclite d’artistes et d’intellectuel·les plus ou moins snobs… ?
Peut-être est-ce une réaction toute personnelle qui vient de ma propre insécurité et de mon propre sentiment d’illégitimité dans l’écriture ?
Peut-être est-ce parce que les personnages d’écrivant·es des romans que j’ai lus sont juste des gens que je trouverais chiants dans la vraie vie, en dehors de toute considération pour leur métier ?
Je me suis entendue penser, il y a quelques semaines, en lisant un énième quatrième de couv’ où le personnage principal était un·e écrivain·e “Putain mais c’est obligatoire d’écrire un personnage d’écrivain·e quand tu écris ou quoi ?”. Comme si c’était indispensable dans la vie de toute auteur·ice de mettre en scène un·e écrivant·e. Comme si on était obligée de se mettre un miroir devant la tronche et de décrire ce qui s’y trouve et d’en faire un·e héro·ïne pour gagner son badge d’écrivain·e officiel·le du Club des Gens qui Écrivent des Histoires.
Je sais très bien qu’on puise tous·tes plus ou moins en nous-même pour écrire nos personnages, qu’on va tous·tes chercher à un moment dans nos vécus, dans nos expériences, dans nos sentiments pour décrire ce qui se passe dans la tête et dans leur cœur de nos héroïnes, mais est-on obligée d’écrire des gens qui écrivent ? N’y a-t-il pas des métiers, des vies, des histoires bien plus excitantes ou parlantes que celles des écrivain·es à raconter dans les livres ? Sommes-nous à ce point fasciné·es par ce que nous faisons ?
Est-ce que ce trope de l’écrivain·e n’est pas juste une énorme branlette, et nos textes des éjaculats prétentieux, pour dire à quel point nous nous sentons supérieur·es, nous qui savons écrire ? Que nous seul·es comprenons à quel point l’esprit d’un·e auteur·ice est complexe ?
Je n’ai pas de réponse à ces questions, vraiment. Je ne sais pas. Sûrement. Peut-être.
Peut-être pas.
Ou alors s’agit-il de faire du fan service pour les lecteur·ices en leur offrant un cliché à mâchouiller pour qu’ielles nous lient ? Tenez les enfants, un roman où un·e auteur·ice de roman apparait, venez voir, c’est exactement ce que vous imaginez ! Ce sont des gens très inspirés, vous savez, des esprits complexes, vraiment différents des autres, de vous, du monde entier ! Oh oui, ielles ont un regard tellement acerbe et poétique sur notre monde, une vision que vous, simples mortel·les n’aurez jamais, oh non !
Alors, que les auteurs et les autrices, t’as pas plus normcore que ces gens-là ! On passe nos journées à glander devant l’ordi en buvant des tisanes et en foutant jamais le nez dehors parce que le monde est plus intéressant dans notre tête. On est des foutu·es nerds qui inventent des quêtes de D&D à longueur de journée, quêtes auxquelles on n’est même pas certain·es que qui que ce soit vienne jouer ! On est des zinzins qui peuvent lire des thésaurus entiers pour trouver le synonyme parfait pour décrire la couleur d’un stylo parce que ouh la la c’est important de pas dire “bleu” trop de fois dans le même paragraphe !
C’est peut-être ça qui m’agace le plus dans le trope de l’écrivain·e, qu’on essaye de nous faire croire que ce sont des gens hors-du-commun alors que ce sont des gens comme vous et moi.
Parce que tout le monde a le droit et le pouvoir de raconter sa propre histoire quoiqu’en disent les snobs du stylo.
Un écrivant que j’aime bien
Martin Winckler

D’ailleurs, comme je suis en train de lire un de ses romans, j’ai envie de parler un peu de Martin Winckler.
Lui, par exemple, je ne le range absolument pas dans la case des auteur·ices qui véhiculent le trope de '“l’écrivain·e = être de lumière” (et pour être franche, il y a quand même beaucoup d’auteur·ices qui le rejoignent dans cette catégorie, le monde n’est pas fait uniquement de gens qui écrivent des personnages d’écrivain·e relou et clichés).
Martin Winckler, déjà, il ne te parle pas d’écrivain·e mais d’écrivant·e (mot que j’ai parfois employé dans la note précédente d’ailleurs) qu’il trouve plus “descriptif et plus inclusif”.
Le mot écrivain, en revanche, est lourdement connoté. Il désigne une personne publiée et/ou désignée comme telle par les autres écrivains, les critiques, les institutions. C’est un mot chargé de statut social et, de ce fait, élitiste et discriminant.
Martin Winckler, Ateliers d’écriture, 2020, P.O.L. Extrait du chapitre “De l’expérience à la fiction”, partie “Qui a le droit d’écrire ?”
Il a cette vision de l’écriture, qu’il qualifie d’assez anglo-saxonne (et je pense que je suis en partie d’accord avec lui là-dessus), plus ouverte, plus accessible, dans laquelle chacune est libre de s’inclure et que chacune est libre de s’approprier pour raconter son histoire. Et ça, j’aime beaucoup. Cette vision m’a permis, après avoir assisté à une mini-masterclass qu’il a donnée en distanciel par le biais de l’école Les Mots, de me libérer un peu de ma peur et de mon sentiment d’illégitimité. Rien que pour ça, je ne peux que l’apprécier et le remercier.
Je pense que beaucoup de personnes voudraient écrire, mais ne se sentent pas le droit de le faire. Car, en France, parmi toutes les formes d’expression artistiques, aucune n’est plus réservée que l’écriture. Personne ne trouve à redire qu’enfants ou adultes prennent des cours de piano ou de guitare, de danse ou de peinture. Mais pendant très longtemps, l’évocation d’ateliers ou de cours “création littéraire” déclenchait presque toujours des commentaires hautains : “Pff ! Dans ce pays, il y a plus de plumitifs que de lecteurs ! Les éditeurs croulent sous les manuscrits sans intérêt ! Et puis d’abord, écrire, ça ne s’apprend pas !” Faut-il préciser qu’il s’agit là d’un préjugé de classe ? Un préjugé ancré si profondément qu’il passe pour la norme et dissuade bon nombre de personnes de seulement formuler leur désir d’écrire ?
Martin Winckler, Ateliers d’écriture, 2020, P.O.L. Extrait du chapitre “De l’expérience à la fiction”, partie “Qui a le droit d’écrire ?”
Autre chose intéressante avec Martin Winckler, c’est qu’il utilise dans deux livres qu’il a écrit (et peut-être d’autres mais je ne les ai pas tous lus encore) et dans la vie de tous les jours, le féminin générique, c’est-à-dire “l’utilisation de formes grammaticalement féminines pour référer à des femmes et des hommes (voire à des personnes non binaires)”. Et c’est sur cet aspect que j’avais envie de plus me pencher en parlant de lui.
La première fois, dans la vraie vie, qu’un homme a employé le féminin générique en ma présence, c’était un gynécologue. J’étais allée le consulter parce qu’il était référencé sur la liste des soignant·es inclusif·ves et safes Gyn&Co et que le gynéco qui me suivait jusqu’alors était un gros sale con misogyne et mal-traitant. Dans la conversation, alors qu’on parlait de mes règles, de ma contraception, de ma grossesse, de mon accouchement et de tout ce qui tournait autour de mon utérus et mon vagin, il a dit un truc du genre “oh et puis de toute façon, on est toutes pareilles dans ces cas-là” (je ne sais plus de quoi on parlait exactement, si c’est de gestion de la douleur ou de la fréquence des règles, bref) et dans ma tête et dans mon cœur, il y a eu comme une explosion, comme un petit boum fait de fleurs roses et de papillons et d’arcs-en-ciel. J’ai vraiment trouvé ça fou qu’il emploie cette forme-là, qu’il se désigne comme étant l’une des nôtres, qu’il s’inclue dans la condition féminine alors qu’on parlait d’un truc qu’il n’avait certainement jamais vécu mais auquel il avait maintes fois été confronté dans sa profession. Et que, surtout, pour un homme, que ça ne le dérangeait pas d’être rangé dans la catégorie femme.
Pour la première fois dans ma vie (et j’avais déjà passé les 30 ans), un homme cis hétéro tout ce qu’il y a de plus droit dans ses bottes d’homme se genrait au féminin, sans que ce soit ni un effet comique, ni une insulte, ni quelque chose de dénigrant. C’était normal. On était en train de parler de tuyauterie utérine, il était donc normal pour lui de dire “toutes” au lieu de “tous” parce que la majorité des personnes possédant un utérus sont des femmes (même si, pas que).
Ce que je n’avais pas réalisé, c’est que l’emploi de la forme féminine de manière générique avait une autre fonction que de vouloir montrer sa solidarité d’allié·e, même si sur le moment, c’était probablement l’une de ses raisons de l’utiliser.
L’impact de l’emploi du féminin générique est bien plus grand que cela et je m’en rends compte véritablement en lisant le roman de Winckler “L’École des Soignantes”.
Tout au long du livre, l’auteur emploie le féminin générique parce que l’histoire se déroule dans une école et un hôpital féministes et que c’est la norme d’y parler et y écrire comme cela. Le résultat, en dehors du livre, c’est que dans ma tête, quand des tournures au féminin générique apparaissent, au lieu de projeter des images mentales où les persos sont uniquement masculins, ils sont désormais féminins. Par exemple, quand il dit “des policiers”, dans ma tête, j’aurais habituellement vu un groupe d’hommes en uniforme avec casquette et sifflet et, pas forcément de femmes alors que dans le groupe, il aurait pu y avoir potentiellement des femmes. Mais comme il dit “des policières”, j’ai projeté dans mon imagination un groupe de femmes flics. Et il se produit la même chose quand il emploie “chercheuses” au lieu de “chercheurs”, “habitantes” au lieu de ”habitants”, “soignantes” au lieu de “soignants”… Du coup, son histoire, dans ma tête, se féminise et je sens que petit-à-petit mes représentations mentales évoluent et se féminisent elles aussi. Et si mes représentations mentales évoluent, ça peut aussi fonctionner dans l’esprit d’autres personnes, voire de millions de gens.
Modifier les représentations mentales permet de modifier la réalité.
Si l’on féminise notre discours, on inclue les femmes dans des situations d’où elles avaient été exclues “involontairement” par le biais du langage. Dans les livres, dans les discours, il n’y a plus uniquement des “chercheurs” mais aussi des “chercheuses” et ainsi, ça devient plus facilement vrai dans la réalité. Plus évident.
Dans Ateliers d’Ecriture, Winckler explique son emploi du féminin générique pour les tournures plurielles plus particulièrement, dans une note de bas de page appliquée à la phrase “J’ai animé un bon nombre d’ateliers de formation pour des professionnelles de santé”.
Dans leur immense majorité, ce sont des femmes. C’est également le cas de personnes qui lisent et participent à des ateliers d’écriture. Et c’est probablement le cas de celles qui écrivent. Dans ce texte, comme dans L’École des Soignantes, j’utiliserai toujours le féminin pluriel pour désigner les personnes qui étudient (étudiantes), écrivent (écrivantes), lisent (lectrices), m’envoient des messages (correspondantes) ou s’inscrivent à mes ateliers (participantes). Ce n’est pas plus arbitraire que d’utiliser le masculin pluriel, mais c’est plus conforme à la réalité.
Et dans L’École des Soignantes il l’explique également, dans le texte :
La première hiérarchie est celle du genre. Pour signifier qu’elle n’a pas de place dans les soins, tous les termes désignant les hôtes, le personnel de l’hôpital et les membres de l’École sont désormais employés au féminin. Qu’elle se considère comme étant femme, homme, cis, intersexe, transgenre ou queer, chaque personne travaillant au Chht ! est désormais une professionnelle, une membre du personnel, une soignante en formation, une soignée. Cette convention simple, mais déterminante, est clairement mise en avant dans tous les documents d’inscription et d’embauche.
Ou encore :
Les fondatrices de l’École avaient lu aussi Small Is Beautiful, le livre de Schumacher qui plaidait pour la microéconomie, les structures à taille humaine et l’autosuffisance communautaire… Alors, au lieu de s’échiner à changer le monde, elles se sont dit : “On va juste essayer de changer le petit monde de la fac et du centre hospitalier.” Et elles ont commencé par le vocabulaire. On n’a plus parlé de “patients” ou de “malades”, mais de soignés, pour souligner que la relation de soin ne transforme pas les personnes – elle ne fait que les mettre dans une situation différente de l’ordinaire. Le projet s’appelait encore l’École des soignants, au masculin. L’aile la plus radicale du groupe a fait remarquer que ça restait une structure hiérarchisée et patriarcale, y compris dans les termes, alors que la plus grande partie du travail était accomplie par les femmes, que les femmes sont plus souvent demandeuses de soin, et que leurs besoins ont été de tout temps systématiquement dénigrés et leur expérience passée sous silence… Pour que le projet soit vraiment révolutionnaire, il fallait créer une École de soignantes. La plupart des hommes qui participaient au mouvement se sont solidarisés avec cette démarche. Les autres sont partis se faire voir ailleurs.
En gros, écrire en employant le féminin générique, comme utiliser l’écriture inclusive que j’aime beaucoup (déso pas déso), aide à rendre visibles celles qui ne le sont pas assez dans le monde de tous les jours.
Representation matters, on ne le dira jamais assez. Merci Monsieur Winckler de tenter de normaliser cette façon d’écrire et de parler.